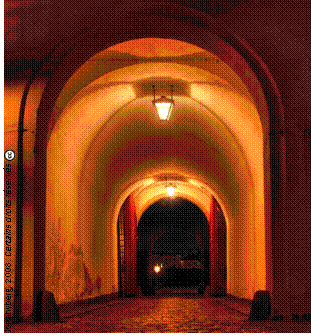J’ai eu la chance de participer, en octobre 2011, à un séminaire sur les discriminations que peuvent vivre les jeunes dans l’espace public et à l’école, dans le cadre du douzième Atelier international de recherche et d’actions sur les discriminations et les inégalités qui a été organisé par le CREMIS à Lille en France. À cette occasion, une délégation québécoise de chercheurs, de jeunes, d’intervenants communautaires et institutionnels, est partie rencontrer une délégation française de jeunes et d’intervenants. Il s’agissait d’un groupe hétérogène, tant en ce qui concerne l’âge, la profession, le champ d’études que l’origine.1
Ce texte ne se veut pas un descriptif de nos travaux, mais mon point de vue de travailleur social quant à l’importance de la collaboration entre le monde de la recherche et celui de l’intervention « terrain », en utilisant cette expérience comme appui.2
D’emblée, il apparaît essentiel que les milieux de la recherche et de la pratique continuent de collaborer et de questionner cette collaboration afin de rapprocher ces deux mondes qui sont parfois éloignés. Par contre, pour que cette union porte ses fruits pour la population que nous desservons, il est important de réussir à sortir d’une dynamique relationnelle « parasitaire », que j’observe et à laquelle je participe.
Cette qualification, qui peut paraître peu élogieuse, s’applique à une relation au sein de laquelle seul l’un des deux partis impliqués bénéficie de la contribution de l’autre. Cela peut être le cas, par exemple, d’un chercheur venu rencontrer un intervenant afin d’obtenir de la « matière première », lui permettant d’écrire un essai ou de réaliser une recherche qui n’apportera aucun bénéfice direct au travail réalisé par les intervenants. À l’inverse, on peut imaginer le cas d’un travailleur social allant questionner un chercheur afin d’obtenir les données les plus récentes de ses recherches dans le but d’améliorer une intervention ou de mettre sur pied un atelier de prévention-promotion, sans que l’apport du chercheur n’y soit reconnu.
Comment changer cette relation ? L’expérience vécue à Lille permet d’identifier certaines variables pour repenser la relation « terrain/recherche ». Les deux semaines que nous avons passées ensemble à réfléchir et à débattre ont permis de dépasser cette relation « parasitaire » et de créer un projet commun qui va au-delà des observations de chacun. Pour en arriver là, certains obstacles ont dû être surmontés.
Culpabilité et temps
Le premier obstacle rencontré en tant que travailleur social au sein d’un CSSS fut de devoir faire face à ma culpabilité : celle de ne pas être sur le terrain pendant presque deux semaines et de laisser à mon équipe, déjà débordée, la charge de mes dossiers en cas de crise. J’ai aussi dû accepter l’impossibilité de justifier l’avancement de mon travail à travers les outils de reddition de comptes habituellement fournis par mon employeur. Finalement, j’ai dû faire face au regard des autres, certains me disant en blaguant que je prenais « des vacances » pendant deux semaines. Il est difficile pour les intervenants de sortir de l’action. Admettre cette culpabilité et prendre le temps de l’accepter nous a permis à Lille d’être plus disponibles pour se plonger dans les travaux de réflexion collective.
Prendre le temps nécessaire m’apparaît comme un élément incontournable pour une réelle collaboration chercheur/intervenant. Combien de fois est-il arrivé à des intervenants de perdre patience pendant un processus de réflexion critique et demander impérieusement que l’on « passe à l’action »? Il faut comprendre qu’à ce moment, il est possible qu’ils fassent en réalité écho à leur propre malaise de ne pas être en train d’intervenir.
Aussi, dans plusieurs milieux (pas seulement les CSSS), il nous est demandé constamment de faire plus avec moins ; moins d’argent, mais surtout, moins de temps. La réflexion sur les pratiques discriminantes dissimulées, comme le traitement différentiel des élèves en difficulté d’apprentissage dans une école, ne peut se faire de façon originale, ouverte, sans jugement et rigoureusement, en incluant enseignants, intervenants du communautaire, du CSSS et des chercheurs, en seulement trois heures lors d’une demi-journée pédagogique.
Une démarche de travail favorisant une proximité sur le long terme entre chercheurs et intervenants peut amener des résultats positifs. Un exemple illustrant cette idée est celui du comité sur la condition homosexuelle et bisexuelle du CSSS. Depuis un an, un chercheur s’est joint à nous, car il est en train d’effectuer une recherche sur les services du CSSS en lien avec cette population. Au fil du temps, il est devenu plus qu’un chercheur venant faire des mises à jour de ses travaux. Il est devenu un membre à part entière du comité et participe à tous les échanges, même ceux qui ne touchent pas directement sa recherche. Ce faisant, le comité est devenu un lieu de travail propice et riche en innovation, où la recherche contribue de façon constante à l’amélioration des interventions sur le terrain.
Si la volonté de nos institutions universitaires est de contribuer à un réel rapprochement entre pratique et recherche, ils devront convaincre les CSSS du bénéfice pour la population de sortir d’une logique d’indicateurs de performance et d’accepter de prendre du temps pour réfléchir sur les pratiques.
Perte de repères
Le troisième obstacle à la collaboration entre chercheurs et intervenants repose sur les réflexes acquis d’intervenants, qui priorisent la tâche, la réalisation d’objectifs clairs et le développement d’un plan d’intervention. Pour atteindre une synergie entre les participants des deux délégations à Lille, un certain laisser-aller était nécessaire. Le « chef d’orchestre » de ces travaux nous a demandé de lâcher prise sur certains modes de fonctionnement qui nous sont chers et de lui faire confiance. Pour un intervenant institutionnel, ce type d’investissement peut se montrer quelque peu « contre-nature », du moins pendant les heures de travail. Cet obstacle était en réalité une variable importante du cheminement ayant pour but de penser différemment les problématiques de discrimination que vivent les jeunes de nos deux pays. Ce lâcher-prise a permis de sortir de notre zone de confort intellectuel.
Afin d’atteindre cet objectif, il a fallu un ingrédient essentiel : la perte de nos repères. Cette perte de repères fut vécue rapidement, le groupe étant composé de vingt-deux personnes qui, en majorité, ne se connaissaient pas. Un pays différent, quatre groupes devant partager leur quotidien. Malgré l’accueil chaleureux de la part de nos partenaires français, nous avons tous vécu une sortie rapide et certaine de cette zone de confort qui, des fois, nous empêche de nous regarder différemment, élément essentiel à la démarche proposée.
Les discussions commençaient tôt le matin en attendant le tramway qui, après 45 minutes de route, arrivait à destination : une station de métro de Lille, à partir de laquelle nous entamions la deuxième partie du trajet. Elles se terminaient tard le soir, alors que nous faisions les courses pour le souper. Tous ces éléments ont servi à créer un environnement propice aux échanges, marqué par l’ouverture et la transparence, et moins empreint des mécanismes de défense qui, trop souvent, dictent notre rapport aux autres. Il ne s’agit pas de mettre dans ce type de situation tous les chercheurs et praticiens souhaitant travailler et réfléchir ensemble, mais plutôt de créer un réel partenariat en collaborant dans un contexte inhabituel où tous n’ont en commun que le fait d’être déstabilisés.
L’expérience de cet atelier international a changé ma façon d’intervenir. Depuis mon retour, je suis plus sensible aux discriminations dissimulées dans mon travail. Les traitements différentiels offerts aux jeunes « en grande difficulté » deviennent, trop souvent, rigides et systématiques, entraînant ainsi une forme plus subtile et dommageable de discrimination, pourtant faite dans le but de défendre l’intérêt de l’élève.
Il y a d’autres variables qui font que la collaboration et la synergie entre le monde de la recherche et de la pratique peuvent donner des résultats impressionnants. Celles mentionnées dans ce texte résument simplement ma perception comme travailleur social des éléments qui m’ont marqué lors de ces jours de travail intensif et partagé.
Notes
1 : Dans la Revue du CREMIS, vol.4, no. 4, l’un des nôtres, Pierre-Luc Lupien, agent de recherche au CREMIS, explique à partir de ses perceptions ce que nous avons accompli là-bas dans un excellent texte nommé « En route vers Watrelos ».
2 : Lors du dernier Rendez-vous Jeanne-Mance, intitulé « Quand recherche et pratique s’unissent pour mieux agir sur les inégalités sociales », on m’a demandé de parler de mon expérience vécue en octobre 2011.
Télécharger le document
Télécharger (.PDF)Auteurs
- François Pépin
- Travailleur social scolaire, CSSS Jeanne-Mance